
La finance est un sujet bien trop sérieux pour le soustraire au débat politique
La finance est depuis longtemps au cœur de nos préoccupations et de nos champs d’intérêts. Elle est un domaine dans lequel les anciens de l’Ensae sont très présents, reconnus et appréciés. Elle est aussi au cœur des mécanismes économiques, irriguant ici la croissance des pays plus riches, là le développement de pays émergents. Elle est au cœur des débats qui agitent ce monde. Bienfaitrice ou nuisible selon les goûts, à libéraliser davantage ou à réguler d’urgence, selon les tenants de telle ou tel école. Les spécialistes de la finance sont donc au cœur d’un débat qui dépasse les aspects techniques de la chose, et pose une réelle question politique. Quelle organisation voulons-nous de ce monde ? Dans quel objet ? Pour poursuivre quel idéal ? Voulons-nous poursuivre un idéal ? Les enjeux d’un domaine qui suscite tant de fantasmes impose un devoir : celui de répondre à ces débats, de les éclairer, d’y prendre position.
Il n’est donc pas envisageable de se soustraire à un sujet aussi éminemment politique. Il faut au contraire saisir l’occasion, avant que d’autres imposent leur choix, sans partage.
Le poids de la finance a fondamentalement transformé le paysage économique
L’essor du capitalisme financier est un phénomène majeur des deux décennies passées. Il n’est pas nouveau, mais d’ampleur, dit-on, inégalée. Mais au-delà des flux impressionnants qui caractérisent les montants échangés au quotidien sur les principales places financières ou boursières, le poids de la finance a fondamentalement transformé le paysage économique. Selon l’approche orthodoxe, les marchés financiers sont dits « efficients » : chaque opérateur prend ses décisions de vente ou d’achat de titres avec les informations dont il dispose, si bien que les prix s’établissent à un niveau reflétant toute l’information existante, délivrant une évaluation correcte des titres cotés, et donc autorisent des choix rationnels pour les investisseurs. Mais celui qui opère sur le marché est « aussi » mû par la recherche du plus grand gain. Il se doit donc de savoir comment les autres opérateurs vont réagir à un moment donné. Si son anticipation est correcte, il gagnera de l’argent, en ayant su anticiper les variations de prix avant les autres. Si chacun se trouve dans une situation similaire, la rationalité devient alors autoréférentielle et débouche sur un prix qui reflète davantage une croyance partagée. Chacun fait comme il pense que les autres pensent. Ainsi, d’une manière générale, les opérateurs sur les marchés adoptent la même convention. La règle est donc le mimétisme. Un certain Keynes s’est déjà prononcé sur ce sujet. Or chaque micro-décision n’engage que soi et la responsabilité individuelle est diluée dans le flot commun. Le mimétisme assure ainsi une certaine cohésion, il est peut être même au fondement d’un sentiment d’appartenance à une communauté.
La finance contribuerait donc à tisser cette nouvelle forme de « lien social ». Fini le sentiment d’appartenance, l’adhésion à un projet collectif ? Certainement pas. Bien au contraire : un nouveau projet suscitant l’adhésion collective tend à s’imposer : la réussite individuelle sans partage, dégagée de cet Etat encombrant qui intervient, libérée de la politisation des politiques économiques politiciennes.
La rationalité attribuée aux acteurs financiers finit même par devenir un objet imité. Ainsi, peu à peu, un projet commun se met en place. Il s’agit d’une construction politique, ambitieuse, qui suscite l’adhésion, parce qu’elle va chercher un dénominateur commun en chacun de nous : l’individualisme.
Un nouveau projet suscitant l’adhésion collective tend à s’imposer : la réussite individuelle sans partage
La démarche financière s’inscrit de fait dans une convention : « la hausse ». A long terme, on comprend bien pourquoi. Mais même à court terme, cette convention sert de moteur. Et la mutation est profonde. Le concept économique de « valeur » renvoie moins aujourd’hui à la production de biens et services, qu’à la valorisation du capital. Dans le cas des entreprises cotées, sous la pression des exigences de rendement des marchés financiers, les dirigeants d’entreprises donnent de plus en plus d’importance aux logiques de financement qu’à la production. Il faut créer de la valeur pour les actionnaires.
Ainsi, le succès d’une opération financière passe de plus en plus par la communication et l’opinion. Les marchés financiers deviennent donc plus que jamais des lieux de diffusion d’information supposés déclencher des réactions, des réflexes. Il suffit à la plus value d’être latente, cela séduit l’actionnaire. Espace de communication, la place financière est donc aussi un espace publicitaire. L’abondance d’informations en fait une vitrine où l’on peut observer la santé économique, voire sociale, d’un ensemble, d’une communauté. Le Nasdaq grimpe ? La nouvelle économie est en marche ! Le Dow Jones suit ? La veille économie tient la distance ! Tout va bien.
La finance, fondée sur la forte rentabilité à un horizon individuel, est instable
Les managers se sont ainsi attribué un autre objectif prioritaire. Dorénavant, ils se doivent d’assurer la valorisation des actifs dont ils ont la responsabilité. L’ingénieur cède son fauteuil au financier. Le communiquant prend la place de l’analyste. Il en découle une justification des transformations des rémunérations, désormais para- métrée sur la valorisation du capital. Certains jugent d’ailleurs que tout cela est excessif. Mais l’excès est-il vraiment dans ces primes et autres bonus dont l’unité de compte est le million d’euros ou de dollars ? Or une fois établie, il est pour le moins difficile de remettre en cause une convention de ce type. Il vaut mieux alors pour certains s’en remettre à … la sagesse du marché.
La convention haussière à court terme interdit une croissance des valeurs soutenable. La finance est instable dès lors qu’elle se fonde sur la forte rentabilité à un horizon individuel, donc court. Tirant trop peu de leçons des crises passées, les acteurs des différents marchés sont sous la domination d’une culture de l’immédiat, et pour lesquels les performances rapidement visibles prennent un poids disproportionné. Les corrections se font donc « nécessairement » sous forme de crise. C’est peut être ici une façon d’expliquer pourquoi les marchés financiers ne peuvent pas s’autoréguler. « Ils » ne se réformeront pas d’eux-mêmes, « ils » ne savent pas évoluer vers une meilleure proportionnalité de ses résultats avec les besoins de l’économie « réelle ». D’ailleurs, là n’est pas leur rôle. Il faut donc leur donner un régulateur. Les bienfaits théoriques de la libéralisation financière sont en grande partie démentis par la réalité. Course effrénée aux rendements, comportements moutonniers, effets de levier et contagion ont fragilisé la mondialisation financière. Même les plus orthodoxes le disent aujourd’hui : il est temps de réguler.
Même les plus orthodoxes le disent aujourd’hui : il est temps de réguler
Mais quelle est la bonne solution, entre la main trop imprévisible des marchés financiers et les mains souvent visibles des Etats ? Faut-il espérer que l’opinion pénètre ces lieux de décision et pèse sur son orientation actuelle ? La question n’est pas d’opposer des citoyens aux marchés financiers, ni de dire que les premiers sont les victimes des seconds. Il ne s’agit pas de rejeter les marchés financiers. Au passage, méfions-nous de ce type de personnalisation, qui permet trop souvent d’éviter une controverse, et de rejeter loin de soi la responsabilité d’un problème.
La question est de poser les termes du débat, de poser une question simple : comment réguler ces marchés ? Toute crise offre une opportunité… La première question n’est pas « quel monde voulons-nous construire ? », mais plutôt « quel monde devons-nous construire ? ».



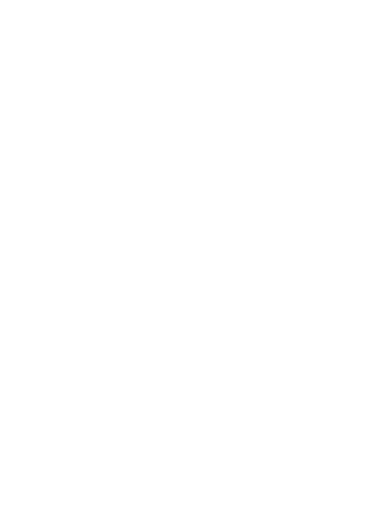

Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.